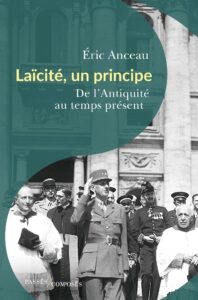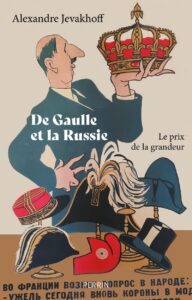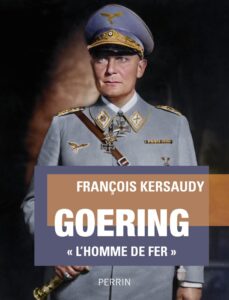
Langue : Français
Broché : 421 pages
ISBN-10 : 2262101027
ISBN-13 : 978-2262101022
Poids de l’article : 880 g
Dimensions : 16.4 x 3.2 x 21 cm
Goering, aviateur courageux durant le premier conflit mondial, ne ressemble pas à l’image du nazi que l’on a en tête. Cela, « c’est la face humaine de l’homme, […] qui a connu les horreurs de la guerre, qui veut voir grandir sa fille, qui aimerait jouir en paix de ses richesses, qui a tiré toutes les conclusions du fait que sa Luftwaffe n’est pas encore prête pour un conflit d’envergure. » (p. 164) Mais Goering est un être faible, veule, tremblant de peur à l’idée de déplaire à son patron. C’est un suiviste, un suiviste dangereux, qui ne fait rien pour retenir les velléités guerrières d’Adolf Hitler. C’est aussi et surtout un dilettante qui fuit le réel. L’auteur consacre des pages entières à montrer l’incompétence de Goering, une incapacité qui a coûté cher à l’Armée allemande. L’incompétence est de peu de poids par rapport à la responsabilité morale de ce morphinomane invétéré, pilleur d’œuvres d’art enrichi grâce au sang des peuples conquis. Satrape servile et vaniteux, Goering ressemblait à la plupart des chefs nazis : un médiocre sans scrupules ni conscience.
François Kersaudy, Goering, « l’homme de fer », Perrin, 2022, 421 pages, 25 €
L’extrait : « A-t-il encore l’espoir de vaincre ? C’est difficile à dire, tant se mêlent chez ce satrape habillé en maréchal la lucidité occasionnelle, la servilité récurrente et la vanité omniprésente. » (p. 223)